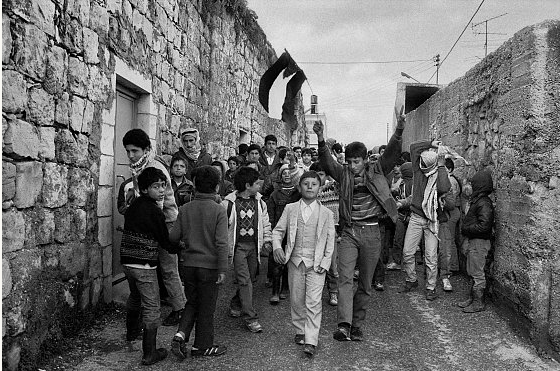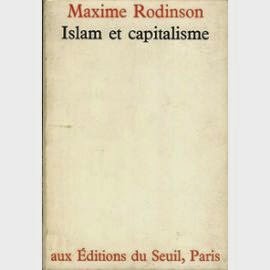Prologue à "Malcolm X. Une vie de réinventions (1925-1965)" de Manning Marable
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
2/22/2015
0
commentaires
![]()
Le choc de l'ignorance
Il avait clairement dans son champ de mire plusieurs rivaux en politologie, des théoriciens tels que Francis Fukuyama et ses idées de fin de l’histoire, par exemple, mais également les légions de ceux qui avaient chanté l’avènement du mondialisme, du tribalisme et de la dissolution de l’Etat. Car, selon lui, ils n’avaient compris que certains aspects de cette période nouvelle. Lui allait annoncer “l’axe crucial, et véritablement central” de ce que “serait vraisemblablement la politique globale au cours des prochaines années”.
Et de poursuivre sans hésiter : “Mon hypothèse est que, dans ce monde nouveau, la source fondamentale et première de conflit ne sera ni idéologique ni économique. Les grandes divisions au sein de l’humanité et la source principale de conflit seront culturelles. Les Etats-nations resteront les acteurs les plus puissants sur la scène internationale, mais les conflits centraux de la politique globale opposeront des nations et des groupes relevant de civilisations différentes. Le choc des civilisations dominera la politique à l’échelle planétaire. Les lignes de fracture entre civilisations seront les lignes de front des batailles du futur.”
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
2/06/2015
0
commentaires
![]()
Covering Islam
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
1/25/2015
0
commentaires
![]()
Libellés : ISLAM
Le huis clos islamophobe
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
1/25/2015
0
commentaires
![]()
Libellés : ISLAMOPHOBIE
Le Zoo humain et la culpabilité blanche masturbatoire
 |
« Où
sont les mains blanches qui nous ont mis en cage ? »
|
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
12/02/2014
0
commentaires
![]()
Les Goulags de la démocratie, Angela Y. Davis
Quand Angela Davis évoque le système carcéral, elle sait de quoi elle parle. Inscrite sur la liste des dix personnes les plus recherchées du FBI suite à de fausses accusations, elle fut d’abord condamnée à la peine capitale puis acquittée en 1972 après seize mois de détention provisoire à New York. Elle a été amenée à réfléchir « à la prison en tant qu’institution - non seulement à l’emprisonnement politique, mais également aux rapports entre les processus interdépendants que sont la criminalisation et la racialisation. » (p.122)
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
11/24/2014
0
commentaires
![]()
Libellés : EMPIRE
Le grotesque est absolument inscrit dans la mécanique du pouvoir...
J’appellerai « grotesque » le fait, pour un discours ou pour un individu, de détenir par statut des effets de pouvoir dont leur qualité intrinsèque devrait les priver. Le grotesque, ou, si vous voulez, l’« ubuesque », ce n’est pas simplement une catégorie d’injures, ce n’est pas une épithète injurieuse, et je ne voudrais pas l’employer dans ce sens. Je crois qu’il existe une catégorie précise ; on devrait, en tout cas, définir une catégorie précise de l’analyse historico-politique, qui serait la catégorie du grotesque ou de l’ubuesque.
La terreur ubuesque, la souveraineté grotesque ou, en d’autres termes plus austères, la maximalisation des effets de pouvoir à partir de la disqualification de celui qui les produit : ceci, je crois, n’est pas un accident dans l’histoire du pouvoir, ce n’est pas un raté de la mécanique. Il me semble que c’est l’un des rouages qui font partie inhérente des mécanismes du pouvoir. Le pouvoir politique, du moins dans certaines sociétés et, en tout cas, dans la nôtre, peut se donner, s’est donné effectivement la possibilité de faire transmettre ses effets, bien plus, de trouver l’origine de ses effets, dans un coin qui est manifestement, explicitement, volontairement disqualifié par l’odieux, l’infâme ou le ridicule. Après tout, cette mécanique grotesque du pouvoir, ou ce rouage du grotesque dans la mécanique du pouvoir, est fort ancien dans les structures, dans le fonctionnement politique de nos sociétés. Vous en avez des exemples éclatants dans l’histoire romaine, essentiellement dans l’histoire de l’Empire romain, où ce fut précisément une manière, sinon exactement de gouverner, du moins de dominer, que cette disqualification quasi théâtrale du point d’origine, du point d’accrochage de tous les effets de pouvoir dans la personne de l’empereur ; cette disqualification qui fait que celui qui est le détenteur de la majestas, de ce plus de pouvoir par rapport à tout pouvoir quel qu’il soit, est en même temps, dans sa personne, dans son personnage, dans sa réalité physique, dans son costume, dans son geste, dans son corps, dans sa sexualité, dans sa manière d’être, un personnage infâme, grotesque, ridicule. De Néron à Héliogabale, le fonctionnement, le rouage du pouvoir grotesque, de la souveraineté infâme.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
10/26/2014
0
commentaires
![]()
Barbarie disent-ils…
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
9/29/2014
0
commentaires
![]()
Vingt-quatre notes sur les usages du mot « peuple »
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
9/22/2014
0
commentaires
![]()
Le Peuple, quelle couleur ?
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
9/22/2014
0
commentaires
![]()
Libellés : MANIERES DE FAIRE
Fractures en Méditerranée
Après avoir été longtemps méconnue, l’influence de la pensée arabo-musulmane sur la culture européenne est l’objet d’une sorte de reconnaissance posthume, d’autant plus vive, il est vrai, que l’éclat projeté vient d’une étoile supposée morte, et nous arrive, brillant à distance, comme un remords ou une nostalgie. Lorsqu’on parle d’ « héritage occulté », il faut savoir qui assume l’héritage et qui l’occulte, qui le reconnaît et qui le rejette. Dire que l’Occident a oublié son héritage arabe risque, en effet, de servir seulement de formulation de rechange pour une thèse que l’on n’ose pas argumenter de face, mais qui, pourtant, domine les opinions publiques des deux côtés de la Méditerranée : les Arabes sont, ont toujours été et seront toujours étrangers à l’Occident.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
8/15/2014
0
commentaires
![]()
Israël, comme hétérotopie occidentale...
L’hétérotopie apparaît comme l’équivalent, rapporté à l’espace, de l’homosexualité, relativement au genre, et de l’hétérochronie, relativement au temps. L’espace est en effet, pour lui, le lieu privilégié de compréhension du mode de fonctionnement du pouvoir. Il ne va pas sans un certain savoir, exploré, véritablement pour la première fois, par Said dans L’Orientalisme, qu’il publia en 1978. L’orientalisme est en effet un colonialisme de l’esprit, une colonisation intellectuelle.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
8/08/2014
0
commentaires
![]()
« Elle n’est point, Gaza, la plus belle des cités…»
 |
| Près de Gaza City, l5 mai 2014 |
Elle s’est ceinte d’explosifs et elle éclate ! Va-t-elle mourir ? S’est-elle suicidée ? Non, non. C’est la manière de Gaza d’annoncer son imprescriptible droit à la Vie.
Voilà quatre ans que la chair de Gaza vole en éclats. Sorcellerie, magie ? Non, non. C’est l’arme avec laquelle Gaza s’acharne à défendre à l’usure son existence !
Voilà quatre ans que l’ennemi, épaté dans ses rêves, béat dans sa passion d’amoureux, fait sa cour au temps… Seulement, à Gaza, impossible ! Elle lui est si peu apparentée, et elle colle à ses adversaires ! Elle est une île, cette Gaza ! A chaque explosion – et elles n’arrêtent pas- le visage de l’ennemi est lacéré, ses rêves se fissurent, et le voici inquiet du temps qui passe, car à Gaza le temps est un autre temps. Le temps de Gaza n’est pas neutre, il n’envoûte pas le monde de froide impassibilité, mais contre le réel il se heurte et il explose ! Le temps là-bas ne transporte pas les enfants de l’enfance à la vieillesse, mais d’un bond, dès leur premier choc avec l’ennemi, il en fait des hommes.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
7/16/2014
0
commentaires
![]()
Gaza : une généalogie
Le cessez-le-feu israélo-égyptien créait une « bande » de 360 km2, où deux cent mille réfugiés palestiniens cohabitaient avec quatre vingt mille résidents du territoire. A la différence de la Jordanie, qui annexa promptement la Cisjordanie (et Jérusalem-Est), l’Egypte refusa toute souveraineté formelle sur la bande de Gaza.
Ben Gourion comprit vite le risque de laisser se développer à la frontière sud-ouest d’Israël un foyer de nationalisme palestinien, à la population composée jusqu’à ce jour de deux tiers de réfugiés. En 1949, le chef du gouvernement israélien proposait en vain à l’ONU d’annexer la bande de Gaza, en contrepartie d’une réinstallation des réfugiés sur le territoire d’Israël.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
7/13/2014
0
commentaires
![]()
De la question palestinienne comme d'un révélateur
Une des questions pour laquelle le déplacement idéologique des frontières est le plus patent est celle des droits nationaux du peuple palestinien. Au niveau international cela conduit à construire l'État d’Israël comme rempart contre l’intégrisme qu’il faudrait défendre à tout prix en dépit de ses violations du droit international et de sa politique génocidaire à Gaza, pour ne parler que de la dernière période. À droite comme à gauche (les frontières ayant été idéologiquement changées) se développent des analyses en termes de « seule démocratie du Proche Orient », du « droit à se défendre de l'État d’Israël ».
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
7/12/2014
0
commentaires
![]()
Libellés : POSTCOLONIE
Islam et capitalisme de M. Rodinson (Avant-propos)
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
7/05/2014
0
commentaires
![]()
Le racisme des intellectuels
C'est déjà du reste cette France "retardataire" qu'on accusait d'avoir voté non au référendum sur le projet de Constitution européenne. On l'opposait aux classes moyennes urbaines éduquées et modernes, qui font tout le sel social de notre démocratie bien tempérée.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/31/2014
0
commentaires
![]()
Libellés : MANIERES DE FAIRE
La singulière histoire de l'Europe
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/22/2014
0
commentaires
![]()
Islamophobie : la fabrique d’un nouveau concept. État des lieux de la recherche
Si la présence de populations musulmanes en Europe et en Amérique du Nord est ancienne, sa visibilité dans l’espace public semble désormais constituer un enjeu politique majeur pour les sociétés occidentales. Les sciences sociales se sont largement saisies de cet objet de recherche depuis les années 1980, mais le sujet demeure sensible et « étudier la « question musulmane » en France revient autant à analyser l’objet que les luttes symboliques – mais bien réelles – qui en définissent les contours et en déterminent la saillance dans le débat public » (Geisser, 2012, p. 351). En d’autres termes, pour étudier la place de l’islam et des musulmans en France, il convient d’étudier les principaux enjeux qu’elle révèle et notamment celui de son rejet. Or, les travaux sur ce nouvel objet d’étude qu’est « l’islamophobie », abondants parmi les publications en anglais, demeurent relativement rares dans les recherches universitaires francophones, comme en témoigne le peu d’ouvrages en français qui utilisent ce terme dans leur titre (Geisser, 2003 ; Deltombe, 2005 ; Mestiri et al., 2008 ; Büttgen et al., 2010 ; Rivera, 2010 ; Esteves, 2011 ; Hajjat & Mohammed, 2013).
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/20/2014
0
commentaires
![]()
Pour un dépassement de la dialectique du Maître et de l'Esclave...
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/19/2014
0
commentaires
![]()
La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses
transformation des savoirs. Je crois pour ma part que la migration est un paradigme tout aussi intéressant pour penser la décolonisation des savoirs. C’est ce paradigme que je souhaite explorer à partir de la si belle expression d’Edward Said, celle de « théories voyageuses ». Beaucoup confondent encore décolonisation et réception, préférant, par exemple, faire de Fanon un lecteur de Sartre plutôt que de Sartre un lecteur de Fanon. La lecture de Sartre par Fanon apparaît ainsi essentielle, celle de Fanon par Sartre inessentielle.
Ainsi, au noble motif de la décolonisation des savoirs, le même partage se reproduit, la même hiérarchie et, pour finir, la même colonialité. En effet, quand Sartre est lecteur de Hegel, on le considère d’abord comme un auteur, même lorsqu’il est, visiblement, lecteur.
Parler de décolonisation des savoirs c’est interroger les transferts de connaissance, la circulation des idées, et se demander ce que l’on a appris, ce que l’on apprend, ce qu’on peut apprendre d’autrui quel qu’il soit et d’où qu’il vienne. Le décentrement que cette attitude implique constitue une nouvelle révolution copernicienne. Dans cette révolution, les Européens ont à réaliser ce qui leur est offert par d’autres qu’eux-mêmes, non-Européens. C’est ce qu’il est convenu désormais d’appeler « provincialisation ». Ils ont à saisir non comment ils ont essaimé leurs connaissances diverses et variées à travers le monde, dans une mondialisation qui n’a pas toujours dit son nom mais comment ils ont intégré dans leurs façons de faire et de penser ce qui leur est venu d’ailleurs. Pour ce faire, la migration est indispensable, qui fait bouger les distances et les limites entre Européens et non-Européens. Pas de migration, toutefois, sans émigration ou sans immigration.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/17/2014
0
commentaires
![]()
Du « devenir-nègre du monde »
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
5/02/2014
0
commentaires
![]()
De l'« archive antimusulmane » médiévale
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
4/29/2014
0
commentaires
![]()
« Frantz Fanon et les langages décoloniaux » (résumé de la thèse)
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
4/25/2014
0
commentaires
![]()
Y a-t-il un « néo-racisme » ?
Une première remarque s'impose. L'hypothèse d'un néo-racisme, du moins pour ce qui concerne la France, a été formulée essentiellement à partir d'une critique interne des théories, des discours qui tendent à légitimer des politiques d'exclusion, en termes d'anthropologie et de philosophie de l'histoire. On s'est peu préoccupé de trouver le lien entre la nouveauté des doctrines et celle des situations politiques, des transformations sociales qui leur donnent prise.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
4/07/2014
0
commentaires
![]()
La France et l’Afrique : décoloniser sans s’auto-décoloniser
En traitant ainsi du colonialisme, l’on prétend que les guerres de conquête, les massacres, les déportations, les razzias, les travaux forcés, les expropriations et toutes sortes de destructions – tout ceci ne fut que “ la corruption d’une grande idée ” ou, comme l’affirme Alexis de Tocqueville, “ des nécessités fâcheuses ”.
Réfléchissant sur l’espèce de guerre qu’on peut et doit faire aux Arabes, le même Tocqueville affirme que “ tous les moyens de désoler les tribus doivent être employés ”. Et de recommander en particulier l’interdiction du commerce et “ le ravage du pays ”. “ Je crois, dit-il, que le droit de guerre nous autorise à ravager le pays et que nous devons le faire soit en détruisant les moissons à l’époque de la récolte, soit tous les temps en faisant des incursions rapides qu’on nomme razzias et qui ont pour objet de s’emparer des hommes ou des troupeaux ”.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
4/06/2014
0
commentaires
![]()
« L'invention de l’immigré » (Hervé Le Bras), un compte-rendu..
En France, on peut donc être étranger, immigré ou pas, français, immigré ou pas. Le Français naturalisé se trouve renvoyé à ses origines, extérieures et étrangères. Hier tout était simple : on était français ou étranger. Aujourd’hui on peut être français, mais Français “immigré”.
La “nocivité” du mot selon Hervé Le Bras est de faire “fi de la naturalisation”, et plus grave, d’avoir “gonflé la partie étrangère en lui adjoignant les naturalisés, ce qui a creusé l’écart entre ces derniers et les Français”. Ainsi, en renvoyant le naturalisé à son étrangeté on élargissait, “le fossé […] entre les Français de naissance et les immigrés”.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
4/06/2014
0
commentaires
![]()
L’islamophobie et les théories critiques du racisme
L’objet de cet article est de réfléchir aux implications théoriques et conceptuelles des études et publications les plus récentes sur le phénomène de « l’islamophobie » dans les pays du Nord, c’est-à-dire principalement l’Europe et les États-Unis. Notre propos suivra quatre étapes :
Premièrement, nous donnerons un court aperçu des développements contemporains au sein du champ universitaire émergent que sont les études sur l’Islamophobie (Islamophobia studies). Deuxièmement, nous discuterons des usages du terme « d’islamophobie » dans certaines des contributions les plus importantes de ce champ de recherche. Nous examinerons ainsi les problèmes produits par l’absence systématique de confrontation avec les théories critiques du racisme. Dans une troisième partie, nous traduirons les conséquences théoriques du défi que représente « l’islamophobie » dans un cadre conceptuel alternatif plus à même de rendre compte du racisme anti-musulmans. Nous examinerons la manière dont celui-ci renvoie à un ensemble de principes fondamentaux d’une critique radicale et marxiste du racisme. Nous conclurons enfin par quelques suggestions sur la manière dont ces considérations théoriques peuvent être aujourd’hui mobilisées dans des stratégies anti-racistes.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
3/17/2014
0
commentaires
![]()
Libellés : ISLAMOPHOBIE
Les approches postcoloniales: apports pour un féminisme antiraciste
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
3/07/2014
0
commentaires
![]()
Préface de « Sur la question noire aux Etats-Unis .1935-1967» de C.L.R. James
Considéré comme un monument dans l’aire caraïbe et dans le monde anglophone, Cyril Lionel Robert James est méconnu, voire inconnu, des lecteurs et des lectrices francophones. Méconnu en partie parce que son empreinte sur la pensée émancipatrice a été écrasée par un seul ouvrage, cardinal il est vrai, Les jacobins noirs. Toussaint Louverture et la révolution de Saint-Domingue. Publié en 1938 à Londres, le livre paraît en français en 1949 chez Gallimard dans une traduction réalisée par Pierre Naville.
Quand on lui demandait qui il était, C. L. R. James, répondait : « Je suis un Noir Anglais ! » ou encore : « Je suis un Noir Européen ! », une réponse qui invite à la réflexion. Nous allons donc essayer dans le court espace de cet avant-propos d’éclairer ce propos en traçant quelques grandes lignes de son parcours. Ce faisant, nous l’espérons, nous donnerons un éclairage sur les raisons qui nous ont conduits à publier en français, plusieurs décennies après leur rédaction, les textes que cet intellectuel marxiste, « noir », « anglais » et originaire de la Caraïbe, a consacrés à la question noire aux États-Unis entre 1935 et 1967.
Publié par
Le Bougnoulosophe
à
3/07/2014
0
commentaires
![]()